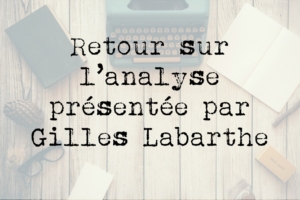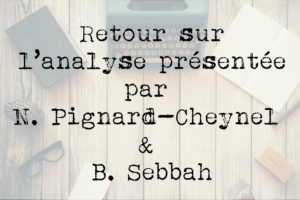Denis Ruellan est Professeur des Universités au CELSA. Anciennement directeur du CRAPE (Centre de recherche sur l’action politique en Europe, Université Rennes 1), il est depuis septembre 2015 chercheur au GRIPIC (Groupe de recherches interdisciplinaires sur les processus d’information et de communication, CELSA Université Paris-Sorbonne). Ses recherches portent sur les transformations du journalisme comme pratique sociale et comme profession.
Dans le cadre du dernier colloque international organisé par le GIS Journalisme, les C3M sont allés à la rencontre du Professeur Ruellan afin de mener une réflexion sur l’impact des évolutions technologiques sur les pratiques journalistiques.
Effeuillage : Diriez-vous que les pratiques journalistiques émergent systématiquement de nouveaux outils mis à la disposition des journalistes ?
Denis Ruellan : Des formes ont préexisté à l’imprimerie. Les lettres manuscrites et les livres, qui étaient reproduits à la main à plusieurs centaines d’exemplaires par des copistes, circulaient et permettaient les échanges marchands, mais aussi la diffusion des connaissances et des idées. L’histoire du journalisme est en permanence marquée par les techniques. Ces techniques émergent hors du milieu médiatique, mais y sont ensuite mises à contribution. L’imprimerie, le télégraphe et les moyens ferroviaires notamment ont favorisé la circulation de l’information et des contenus. Cela reste vrai aujourd’hui. L’internet n’est pas né avec le projet de devenir un dispositif médiatique. C’est avant tout un dispositif d’interaction entre les individus qui, après avoir favorisé les échanges entre les chercheurs, a favorisé les échanges marchands et financiers. Les médias n’ont pas été en retard dans la mise en œuvre de ce moyen pour diffuser les contenus (1). Je pense que l’évolution des dispositifs sociotechniques s’inscrit toujours dans une logique industrielle. Les médias constituent une industrie. On y trouve des producteurs de contenu, ainsi que tout un personnel non journalistique travaillant avec les journalistes. Ce personnel construit notamment les interfaces et insère les contenus au sein des produits médiatiques. Si l’on élargit encore, on voit que l’industrie médiatique fait également appel à du personnel support, à du personnel administratif et à du personnel commercial.
E. : Peut-on dire qu’il y a actuellement, avec le numérique, une accélération dans les mutations des pratiques journalistiques ?
DN : La difficulté de ces métiers est de trouver le bon équilibre entre ce qui change et ce qui reste. On peut s’en sortir avec une litote qui est de dire que ce qui est permanent, c’est le changement. Effectivement, ce qui est permanent, c’est une adaptation à des supports de diffusion et à des canaux d’interaction. Le numérique, c’est la possibilité à la fois de la diffusion des contenus et de l’interaction entre tous ceux qui apportent des éléments au sein de la machine médiatique. Ces deux aspects sont complémentaires. Un même contenu peut être donné à lire via des canaux et des techniques différents, et donc, se déployer sur divers supports. Le multimédia est là envisagé comme un outil de diffusion. Mais cela implique en outre une nouvelle caractérisation du travail du journaliste qui peut lui-même être le producteur de ces différents supports. Un journaliste qui ne serait équipé que de son crayon a peu de chances de voir sa production donner lieu à un web-documentaire ou à un documentaire de télévision. La simplification et la miniaturisation des outils de captation et l’accroissement des compétences des journalistes amènent ces derniers à faire plusieurs choses en même temps. Ce sont des transformations indéniables. Toutefois, je pense qu’il faut tenir compte du fait que les journalistes utilisent des appareils photos depuis très longtemps. Depuis très longtemps, il y a des collaborations entre des médias pour diffuser un même contenu sur des supports différents.
E. : Que pensez-vous de l’essor du statut de journaliste multimédia qui tend à se généraliser ? Outre la question de la multiplication des compétences, ne pensez-vous pas que ce statut peut, sur certains aspects, « affaiblir » voire entrer en contradiction avec le journalisme traditionnel ?
DN : J’en reviens à rappeler la même chose. Je vous donne un exemple. En 1924, le journal La Dépêche (2) diffusait sur la place de Brest un journal par haut-parleur. Voici un autre exemple ; quand le téléphone s’est implanté au sein des foyers, il n’était alors pas seulement utilisé pour des conversations interpersonnelles, mais aussi pour l’écoute de programmes musicaux. On est alors en 1898. Ce que je veux dire, c’est que parler de quelque chose qui mènerait à changer doit toujours tenir compte du fait que tout n’a pas forcement tant changé que ça. Après, on peut effectivement avoir des interrogations sur le fait qu’un journaliste doive tout faire lui-même. Si celui-ci travaille bien, je ne crois pas qu’on puisse généraliser et donner un avis définitif. Ce que je crois, c’est que par certains côtés, la production journalistique s’est considérablement améliorée au sens où les informations sur un même sujet sont plus diverses, plus mobilisées infiniment et plus vérifiées et avec une distance et des précautions plus grandes des journalistes. Aujourd’hui, un journaliste qui, soit par fatigue, soit par fainéantise, céderait à la facilité et qui donc serait amené à mal faire se fait plus vite repérer qu’autrefois. D’un certain côté, le journaliste s’améliore considérablement. D’un autre, il est vrai qu’il y a des circonstances de travail qui mettent une forte pression sur les individus et qui les mènent à fournir un travail de qualité assez banale. Effectivement, le nombre de supports et de canaux de diffusion a explosé. Là où il peut y avoir une dégradation, c’est sur les conditions de travail des journalistes. Mais cette remarque vaut globalement vis-à-vis du travail en général.
1. Le Monde est présent sur Internet avec son propre nom de domaine (lemonde.fr) depuis le 19 décembre 1995.
2. Aujourd’hui Le Télégramme