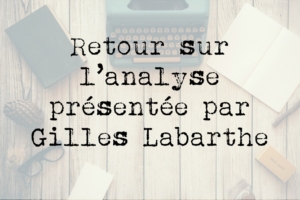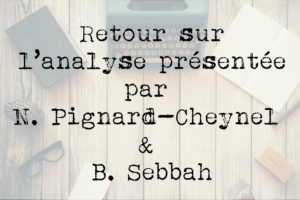Bernard Idelson est enseignant-chercheur en SIC à l’Université de La Réunion, et anciennement journaliste de presse écrite. Ses travaux portent principalement sur les transformations des pratiques journalistiques. Il étudie notamment l’histoire des médias d’information dans l’océan Indien. Dans ses dernières recherches, il confronte les discours technicistes des journalistes à la généalogie des médias réunionnais.
Effeuillage : Vous avez été journaliste pendant plus d’une dizaine d’années, et, de, fait nous aimerions avoir votre regard sur cette idée de l’enchantement face aux innovations techniques dans la pratique du métier de journaliste. Partagez-vous cet enchantement ?
Bernard Idelson : Vous soulevez l’importante question de la réflexivité du chercheur. Ancien journaliste, j’ai dû suivre un chemin assez long pour me distancier du groupe professionnel que j’étudiais. Cela peut faire penser aux deux catégories d’anthropologues qui apparaissent dès le XIXème siècle. Ceux qui venaient d’Europe pour étudier des groupes « indigènes » optaient, souvent sur un temps long, pour une approche dite de « familiarisation », tandis que les membres du groupe qu’ils formaient à l’anthropologie et à qui ils confiaient des travaux devaient, eux, adopter une attitude de « distanciation » vis-à-vis de leurs semblables. Dans mon cas, j’ai dû me positionner entre ces deux approches. J’ai tout d’abord été enseignant de presse écrite à l’Université de La Réunion tout en étant journaliste. C’est ainsi que j’ai pu rédiger une thèse sur la presse écrite régionale. Ma première difficulté fut cette posture de distanciation qui est un peu schizophrénique. Après quinze années de pratique du métier d’enseignant-chercheur, j’en suis au stade où ma préoccupation est au contraire de me familiariser avec le groupe étudié. Lorsque je vais dans une salle de rédaction, je découvre des praticiens de l’information qui font partie d’une famille à laquelle je n’appartiens plus. Il y a également un phénomène d’âge : ils ne sont pas de la même génération que la mienne, même si je retrouve parfois d’anciens « confrères » qui ont survécu, si j’ose dire, aux transformations de la profession. Pour en venir plus précisément à votre question, l’enchantement comme le désenchantement des journalistes face aux innovations techniques, je les perçois donc et les comprends également, mais je ne les partage pas pour autant, puisque je n’appartiens plus à cette sphère professionnelle. D’autre part, mes recherches me font rencontrer une autre catégorie de journalistes travaillant sur le web et issus de notre formation à l’université. J’ai été leur enseignant et ils me considèrent non pas comme un « ancien journaliste » mais comme leur « prof ». Par ailleurs, j’ai longtemps continué à dispenser des cours de pratiques professionnelles en journalisme, et cela permet finalement de bénéficier d’une situation de recherche assez riche, pour comprendre les changements de l’activité « Journalisme ».
E : Vous avez donc évoqué les discours d’enchantement, mais aussi celui de l’anxiété de l’arrivée du numérique, y aurait-il des aspects anxiogènes dans la propagation du numérique dans le journalisme ?
B. I. : Au cours de mes enquêtes récentes, je suis retourné dans toutes les rédactions de La Réunion et j’y ai passé du temps. J’ai pu constater le paradoxe suivant : ceux qui parlent des transformations liées au numérique avec une certaine appréhension ne sont pas ceux qui subissent ou qui risquent de subir le plus une détérioration de leurs conditions de travail. Cette anxiété est souvent exprimée par les plus « anciens » d’entre eux, de même que par les cadres, rédacteurs en chef ou directeurs qui tiennent un discours managériale et plus pessimiste quant aux perspectives économiques de leur entreprise ; j’évoque ici le cas des rédactions de presse écrite réunionnaise. Or, les journalistes les plus anciens vont partir à la retraite et les cadres sont ceux qui sont les mieux lotis en termes de salaire et de conditions de travail. Les situations les plus précaires sont plutôt celles des jeunes journalistes en CDD, voire, à présent, en CDD à mi-temps ! Pour autant, ces jeunes journalistes ne semblent pas se plaindre et se montrent confiants dans l’avenir. Tandis que dans les rédactions pure player, comme dans certaines rédactions de télévision, les discours sur « l’avenir » reflètent au contraire un optimisme à toute épreuve. Il est donc difficile de généraliser, mais on relève bien quand même cette différence constatée entre discours, pratiques et réalité des situations.
E : Est-ce que vous observez une différence entre les réactions à la métropole et à La Réunion ?
B. I. : Il faudrait procéder à des études comparatives de catégories identiques de supports. Mais si l’on compare la presse quotidienne régionale métropolitaine et celle de La Réunion en général, il y a tout de même des évolutions et des contextes socio-économiques assez différents. Parce que leur histoire diffère également. La presse réunionnaise, écrite et parlée, a été un élément important de l’ouverture de l’espace public local, et cela assez récemment, puisque cette ouverture ne s’est produite qu’au début de la décennie 1980.
E : Et justement depuis la Réunion, le numérique n’est-il pas vu comme un moyen de sortir de la dimension locale pour s’ouvrir à l’échelle nationale ?
B. I. : Ce discours « d’ouverture sur le monde » par le numérique est très présent. Mais on retrouve exactement le même chez les acteurs politiques au moment de l’inauguration de la télévision à La Réunion en 1964, ou même antérieurement lors de l’apparition d’innovations technologiques : télégraphie sans fil, ondes courtes, rotatives offset, liaisons satellitaires, etc. In fine, le numérique ne change pas véritablement la réalité géographique de l’insularité et de l’éloignement. La distance, comme le coût du billet d’avion, pour aller voir de la famille ou des proches en métropole, représentent toujours un obstacle majeur. La connexion numérique ne peut remplacer le face-à-face humain… Pour autant, le mythe du « migrant connecté » proche de son île, grâce à internet apparaît très vivace.
E : Au début de votre intervention, vous disiez que vous n’utilisiez pas le mot « mutation » pour désigner les changements liés au numérique, mais plutôt le mot « transformation », pourquoi cela ?
B. I. : Les historiens de la presse ont bien montré qu’en France, le journalisme, depuis sa structuration professionnelle dans les années 1930, et même antérieurement, n’a jamais cessé de se transformer. Durant ce qu’on appelé l’âge d’or de la presse, de la fin du XIXème siècle jusqu’à la Première Guerre mondiale, les tirages se chiffraient en millions d’exemplaires. Cette prospérité ne s’est jamais retrouvée depuis. Par ailleurs, les transformations liées au numérique sont souvent présentées comme extrêmement récentes. Internet existe pourtant depuis 1958, et l’informatisation des rédactions qui a provoqué des changements importants dans la production, remonte aux années 1980. Certes, il ne s’agit pas de nier ce qui se modifie dans la fabrication de l’information, ou dans ses usages, depuis les ventes massives de tablettes ou de smartphones, mais on ne peut pas dire qu’il y ait un avant et un après numérique. On voit bien, à travers les études de cas de ce colloque consacré aux « outils du journalisme », les similitudes et les récurrences des transformations. La métaphore de la mutation me paraît donc trop radicale. Muter, c’est passer d’un état à un autre, en devenant méconnaissable. Une transformation, elle, s’inscrit davantage dans la durée. Or, lors d’une communication du colloque, consacrée à la « langue » des journalistes, Michael Palmer a remarquablement bien fait ressortir que la parole et l’écrit restaient les outils majeurs – et immuables – de la pratique journalistique, au-delà des innovations technologiques.